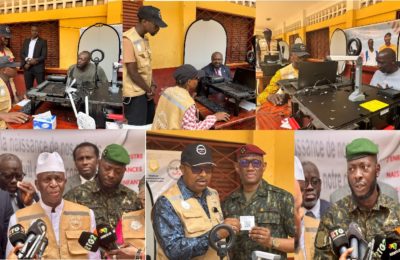Conakry et sa banlieue
L’origine de Conakry est à relier à celle de Kaporo. Le Khamfori Kha de Kaporo de la même souche que le Khamfori Ali de Tomboliya, eut quelque temps plus tard comme parents à Nongo, un Khamfori Massa, et un certain Khamfori Konan parti seul se fixer dans l’île qui prolongeait le Kaloum. Les témoignages du vieux Monomoundouna recoupent à ce propos ceux de l’ancien douanier Kabagnari interrogé en 1927 par Mgr Lerouge, archevêque de Conakry. Sous le grand fromager face à l’actuel ministère du Développement économique et à la Direction du port, habitait un certain Konan. Konan est bien un nom baga du terroir. Ce Konan possédait des palmiers qui donnaient un vin excellent. De sorte que les gourmets du temps, quand ils voulaient vraiment se délecter, y venaient vider les gourdes. Konan devint célèbre avec son vin de palme, et l’on ne parla bientôt plus, les jours de réjouissance, que de passer chez Konan, que d’aller du côté de Konan pour y faire de copieuses libations. Nakiri veut dire en soussou : l’autre bord ; nakirikaï : les habitants de l’autre rive. Pour ceux de Kassa, comme pour ceux de Camayenne, les insulaires de Tombo étaient les « nakirikai » . Conakry (naguère orthographié avec un « ;K » ) est vertu par contraction de Konan nakiri ou Konankiri : du côté de chez Konan « Grammaticalement il n’y a rien à redire à cette construction, mais le malheur, c’est que les Konakry sont nombreux en Guinée. Il y en a un, en face de Marara, et rien ne prouve que c’était la rive où habitait aussi un Konan. En pays malinké, il y a des Khoniakori qui ont apparemment le même sens. On en trouve sur les frontières libériennes : un tout petit village juché à 1 350 m. sur le pic de Konosso. Sûrement qu’il n’y eut jamais de Konan en cet endroit. »(Notes de Mgr Lerouge.).
Landréah, si gentiment peuplé de villas, et Donka, quartier des établissements sanitaires, scolaires et sportifs, de chaque côté de la route de Ratoma, ils ne sont que les anciens terrains d’essais de culture européenne, entre 1900 et 1925 de MM. Landré et Doncat.
Dixinn signifie en baga «installons-nous» , «arrêtons-nous là,»de «diki»arrêt limite, qu’on ne franchit pas au sens propre, et au figuré en parlant des ambitions. Le clan des Bangoura (auquel se sont mêlés plus tard les Sylla, Soumah, Cissé, Touré, etc.) refoulé du Fouta, décida après avoir erré longtemps de s’arrêter et de fixer son habitat vers l’extrémité de cette presqu’île qui, protégée par la mer, n’était à défendre qu’au nord-ouest. Après 1910, l’implantation, sur le terrain de culture du village primitif de Dixinn, de quelques familles peules et toucouleurs, dont certaines comme celle des Sy, avaient servi d’intermédiaires entre l’administrateur de Beeckman et Bokar Biro pour assurer le protectorat français sur le Fouta-Djalon, et dont d’autres étaient en résidence surveillée par l’administration coloniale, a fait distinguer selon la dominante ethnique (les Bagas étant en voie d’assimilation par les Soussous), Dixinn-Soussou devenu Dixinn-Port après l’indépendance par souci d’effacement des différenciations ethniques et Dixinn-Foula devenu Dixinn-Ecole :
Plus loin, Kénian traduit presque en soussou la Bellevue français et veut dire : «Cela me plaît» , de kénen-de = plaire, convenir, être agréable.
Yi wali mu n’kéynen : ce travail ne me plaît pas.
Hafia, faisant suite à la concession de la Compagnie minière, est un village fondé récemment par des éleveurs foulas. Le nom dérive de l’arabe par atrophie et évoque l’idée de santé, de mieux-être, et par extension, de paix et de sécurité. Mi heɓii aafia = je me porte mieux, est la réponse du convalescent que l’on visite.
Maninka-wondi, forêt des Malinkés, à 15 km de l’île de Tombo, porte trace dans son appellation de l’ethnie qui s’y est fixée la première au début du siècle sur un terrain faisant partie de Ratoma.
Taouya, selon la tradition baga, vient de son premier fondateur : Tamou. L’altération s’explique peut-être par contamination avec la signification soussou de ta = village, ouya = nombreux, formé de la même façon que Tatema = pays élevé, Tafori = le vieux village, Tanénè = bourg neuf, Tamara = ce n’est pas un village (île où l’on a installé un phare)
Au-delà de Taouya, nous touchons de nouveau au berceau des Bagas du Kaloum : Ratoma, Rogbané, Kipé et Kaporo.
C’est à Kaporo que l’octogénaire Bangoura Monomoundouna, c’est-à-dire en soussou «le débrouillard» , appelé aussi par sa nombreuse descendance «le père des bagas» , doyen d’âge et mémoire vivante de toute l’histoire traditionnelle du Kaloum, m’a raconté en conseil de village, par l’intermédiaire d’interprètes, quelques phases de la geste de ses aïeux.
Source: Claude Rivière, la Toponymie de Conakry et du Kaloum.Bulletin de l’IFAN. Notes et Documents. Série B: Sciences Humaines, Dakar.
Vol. XXVIII. Nos. 3-4. Juillet-Octobre 1966. pp. 1009-1018